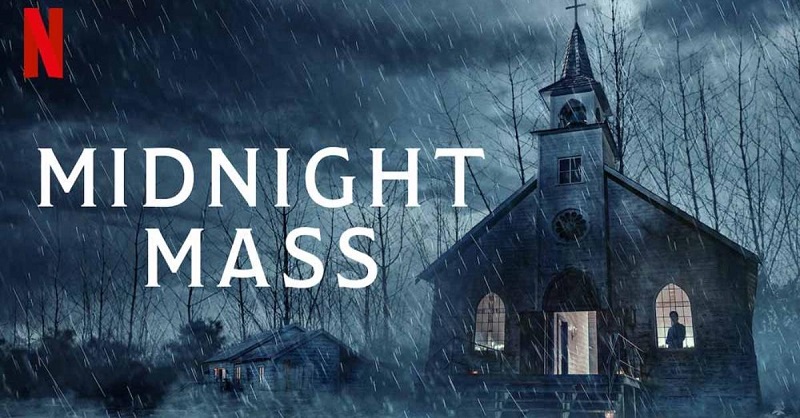Le Cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro est une série Netflix de huit épisodes.
Voyons ça en détail.
Lot 36 (réalisation : Guillermo Navarro) : Le plus décevant
Nick Appleton (Tim Blake Nelson, formidable) est un vétéran qui ne manque jamais une occasion de le rappeler. Ce raciste, qui plus est, gagne sa vie en revendant au détail ce qu’il achète en gros aux enchères, notamment dans des garde-meubles dont les propriétaires ne payent plus leur loyer. Évidemment il perd aux jeux bien plus qu’il ne gagne. Un jour, il acquiert le lot 36, un bric-à-brac qui contient des livres occultes, ce qui va l’amener à croiser la route de Roland, un occultiste inquiétant (mais pas forcément des plus compétents).
Cet épisode est le plus décevant des huit, car la prestation de Tim Blake Nelson est de très haute volée : il incarne une ordure et en même temps on ne peut s’empêcher de lui trouver des circonstances atténuantes. Le scénario ne suit pas et finit par verser dans le satanisme éco+.
Graveyard rats (réalisation : Vincenzo Natali) : Le plus nul
Masson est un pilleur de tombes. Il est en compétition avec les rats qui sont parfois plus rapides que lui pour détrousser un cadavre.
Adapté d’Henry Kuttner, cet épisode ne vaut que pour le nom de Lewis Padgett apparent sur une des tombes du cimetière ; pour le reste, c’est affligeant du début à la fin. Une fois de plus, Vincenzo Natali fait appel à son acteur favori David Hewlett qui joue comme une chaussette trouée.
The autopsy (Réalisation : David Prior) : Le meilleur de tous
Un vieux médecin légiste (F. Murray Abraham, dont on se souviendra éternellement pour son rôle d’Antonio Salieri dans le Amadeus de Milos Forman) est appelé dans un village minier pour autopsier les corps de travailleurs victimes d’une étrange explosion souterraine. Ce qu’il va découvrir dépasse l’entendement.
Très bon épisode inspiré d’une nouvelle de Michael Shea (La Revanche de Cugel l’astucieux, La Quête de Nift-le-mince).
The Outside (Réalisation : Ana Lily Armipour) : le plus chiant
Sans doute influencée par ses collègues de travail qui ne parlent que de grosses bites et, en creux, des moyens de les attirer dans un plumard (la table de la cuisine fera aussi bien l’affaire), Stacey essaye une lotion miracle qui doit la rendre magnifique et lui inflige, pour commencer, des rougeurs impressionnantes et des démangeaisons au diapason. Pour quelques centaines de dollars, à peine, la vilaine chenille arrivera-t-elle à devenir un joli papillon ?
Longuet, convenu, dénué de toute subtilité, cet épisode veut nous faire croire que la vraie beauté est à l’intérieur. Le souci, c’est : « à l’intérieur de quoi ? ».
Pickman’s model (Réalisation Keith Thomas) : la plus mauvaise des deux adaptations de Lovecraft (exæquo)
Si donner le rôle du peintre Richard Pickman à Crispin Glover est la vraie bonne idée de cet épisode, malheureusement le reste est une catastrophe industrielle à oublier d’urgence. Il semblerait que les héritiers de Tolkien considèrent comme une « éviscération » l’adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Là on pourrait dire pareil. Et ça a sans doute plus de sens.
Dreams in the witch house (Réalisation : Catherine Hardwicke) : la plus mauvaise des deux adaptations de Lovecraft (exæquo)
Rupert Grint (Ron Weasley dans la franchise Harry Potter) est un acteur ? Pas vraiment, si on en croit cet épisode calamiteux. Eviscération 2, le retour de la sorcière.
The viewing (Réalisation : Panos Cosmatos) : le plus stylé
Le riche Lionel Lassiter (Peter Weller) invite chez lui quatre pointures dans leurs domaines respectifs (la musique, le roman, les pouvoirs psys, l’astrophysique) à venir voir un objet qui résiste à toutes les analyses. D’abord tout ce petit monde cause, puis picole, puis s’envoie de la cocaïne spatiale avant – enfin – d’aller contempler le mystérieux caillou céleste au centre de cette intrigue psychédélique.
Panos Cosmatos (Mandy) fait du Panos Cosmatos : c’est complétement what the fuck ?! et en même temps le spectacle est presque hypnotique. Comme sur Mandy, je trouve que le réalisateur ne sait pas gérer le rythme de son récit. Ici il y a une énorme (interminable ?) mise en bouche qui donne sur un festin nu assez vite expédié. Peter Weller fait son âge (75 ans) voire davantage. Sofia Boutella fait du Sofia « perverse soft » Boutella à 101%, personne n’en sera surpris. Si la forme est complètement wahou, le fond reste quand même très léger. Mais bon, Mandy nous y avait préparé.
The Murmuring (réalisation Jennifer Kent) : le plus subtile.
Un couple d’ornithologues s’installe dans une maison à l’abandon pour étudier les phénomènes de nuées des bécasseaux. Il sont en deuil. Il aimerait aller de l’avant ; elle n’y arrive pas.
C’est l’épisode le plus subtile, le plus maîtrisé en termes de narration, le plus « Henry James », mais pas forcément le plus enthousiasmant. Paradoxalement on s’intéresse plus aux phénomènes de nuées (chez les étourneaux, les bécasseaux) qu’au deuil qui frappe le couple. La seule chose qui n’est pas subtile dans l’épisode c’est l’insistance du mari à vouloir retrouver un semblant de vie sexuelle.
Dans son ensemble, la série déçoit. Restent les présentations de Del Toro (inspirées de celles d’Hitchcock) très réussies, même pour les épisodes les plus embarrassants.