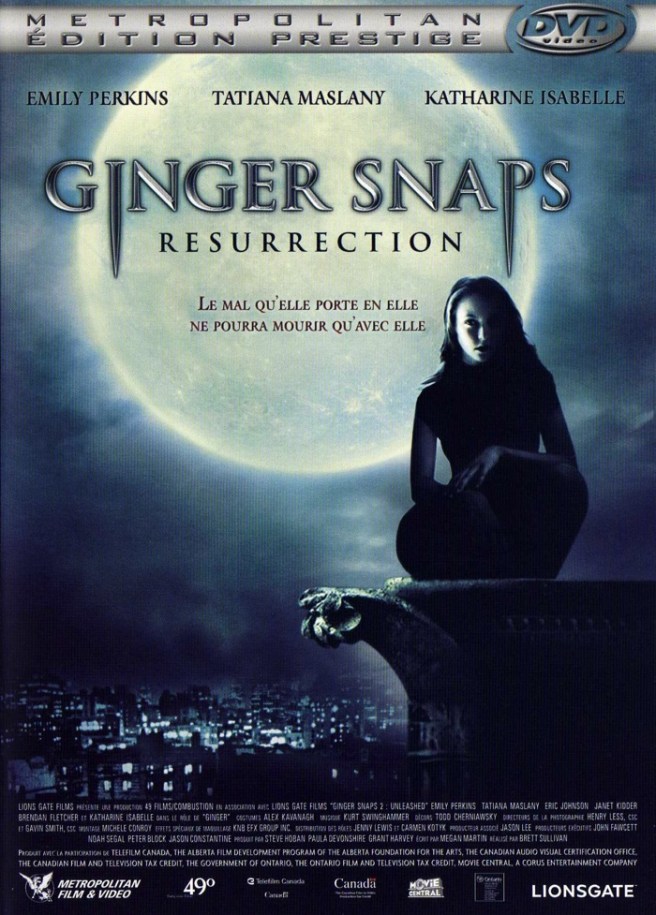Bien occupé par mon vrai travail (tu ne m’avais pas préparé à ça, vieux coq espagnol !), si je trouve encore le temps de regarder des films et des séries TV, je ne trouve plus du tout la demi-heure que nécessite une recension à peu près honorable de mes visionnages.
Jungle, Greg McLean (2017)
Avec Harry Potter. Un film de jungle, en Amérique du sud, une histoire vraie. Je n’ai évidemment pas pu résister à la tentation. Le scénario tient sur une page « notes » d’un Lonely Planet, à condition d’écrire gros. Les acteurs sont bons. Pas un grand film, mais une sorte de film honnête, aux ambitions limitées et bien cernées, que j’ai bien apprécié. Ça n’a pas la puissance de Lost city of Z.
Homicide, David Mamet (1991)
Le meurtre d’une vieille juive dans un petit magasin. Le destin de deux flics (Joe Mantegna et William H. Macy). Je ré-explore le cinéma de David Mamet avec un vrai plaisir. Semblants, faux-semblants, trahisons, quiproquos. Ce n’est peut-être pas le meilleur film de Mamet, mais je le trouve très bon.
Braquages, David Mamet (2001)
J’a acheté tout Mamet en DVD, donc je pioche. Et ce Braquages, je ne l’avais jamais vu. C’est un Mamet mineur avec un casting plaisant : Gene Hackman, Rebecca Pidgeon, Danny de Vito, Sam Rockwell, Delroy Lindo. Comme souvent chez Mamet, le scénario est bourré de petites erreurs/approximations qui semblent volontaires et nous (dé-)montrent que le cinéma est un art de la prestidigitation / l’illusion. Braquages n’atteint pas en la matière le brio de Spartan filmé trois ans plus tard. Avec ses personnages complexes, Braquages dit toutefois des choses intéressantes sur la vieillesse, sur la retraite, sur l’avant-mort.
True Detective saison 1, Nic Pizzolatto (2014)
La première fois que j’ai vu la série, j’ai été terriblement déçu. D’une certaine façon, on me promettait une sorte de thriller lovecraftien / Carcosa / Le Roi en jaune et ce n’était pas ça, au final. Bon j’étais clairement entré dans une pizzeria pour commander des sushis, ça arrive. L’erreur est humaine.
La deuxième vision (je connaissais la fin, l’identité du tueur) a été plus intéressante. J’ai pu me concentrer sur d’autres trucs (loin de ma prime déception). Notamment le jeu de Matthew McConaughey qui en fait des tonnes, le pire étant la scène dans la bagnole où d’une voix mortifère il nous explique la vie, la mort et l’univers. Donc, là, Matthew, je dois t’avouer que j’ai bêtement rigolé. Mis à part ça, il y a quelques scènes qui m’ont scotché, et notamment l’intégralité du dernier épisode que je trouve d’une puissance et d’une tension assez rarement atteintes à la télévision.
La Isla minima, Alberto Rodriguez (2014)
La Isla Minima c’est True Detective dans le sud de l’Espagne. J’avais déjà vu le film, je l’ai revu juste après avoir fini True Detective pour comparer les deux œuvres. Je n’ai pas été déçu, c’est toujours aussi bien, même à la seconde vision. Broyés par des forces qui nous dépassent, nous ne restons que des hommes.