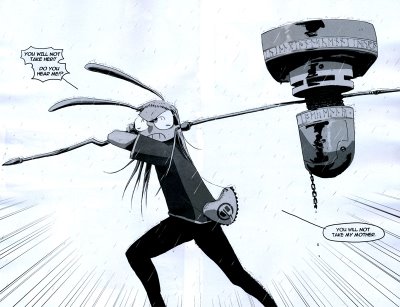Derek Cho, un jeune avocat (Steven Yeun, très bien) au service d’une puissante firme reçoit une jeune femme (Samara Weaving, très bien aussi) qui a un problème de saisie immobilière. « Non, désolé madame, je ne peux rien faire pour vous. Au revoir. » Alors que la jeune femme est sur le point d’être jetée dehors, Derek est viré pour un dossier épineux qu’on lui a refilé en douce, sans le prévenir, et l’immeuble est bouclé, mis en quarantaine, car touché par un virus : le ID7 qui rend les gens totalement désinhibés : capables de s’entre-tuer, de s’engueuler comme de baiser à mort (comme on est en Amérique, les gens préfèrent très vite s’entre-tuer que baiser à mort). Derek Cho connaît bien ce virus et surtout le vide juridique qui couvre les actes que l’on commet en étant malade. Sa supérieure Kara Powell, qui vient de le planter pour sauver ses miches, a intérêt à planquer son fessier et le reste, car le Cho est chaud, bien décidé à régler ses comptes, au marteau si nécessaire (la faucille était en vacances). Et Melanie qui est sur le point de perdre sa baraque, et sent qu’elle n’a plus rien d’autre à perdre, est prête, elle, à clouer au mur le malheureux crétin qui osera se foutre en travers de son chemin.
Ça va gicler : sang, cervelle humaine et aussi un peu de sperme histoire de rosir le mélange.
Trouvé dans un bac de blu-ray d’occasion à un prix ridicule, je me suis dit que je ne risquais pas grand chose. Comme on pouvait s’y attendre, Mayhem n’est ni un grand film ni même un bon film. Par contre, c’est la meilleure adaptation ballardienne que j’ai jamais vue, bien supérieure à High Rise (à un petit détail près, ce n’est tiré d’aucun roman en particulier de J.G. Ballard.) Pourtant… c’est incroyable comme ce film méchant entre en résonance avec I.G.H, Super-Cannes et La face cachée du soleil. Un détail ici, un autre là, un personnage odieux.
Sans doute dans la même veine qu’American Nightmare, cette petite série B foutoir et boule puante utilise l’exagération et le grotesque pour appuyer là où ça fait mal : ce flottement (loin d’un certain réel, trivial) que l’on aperçoit souvent chez les gens de pouvoir qui brassent des millions et sont littéralement en position de broyer des vies.
A condition d’être un poil tordu, on s’amuse bien.