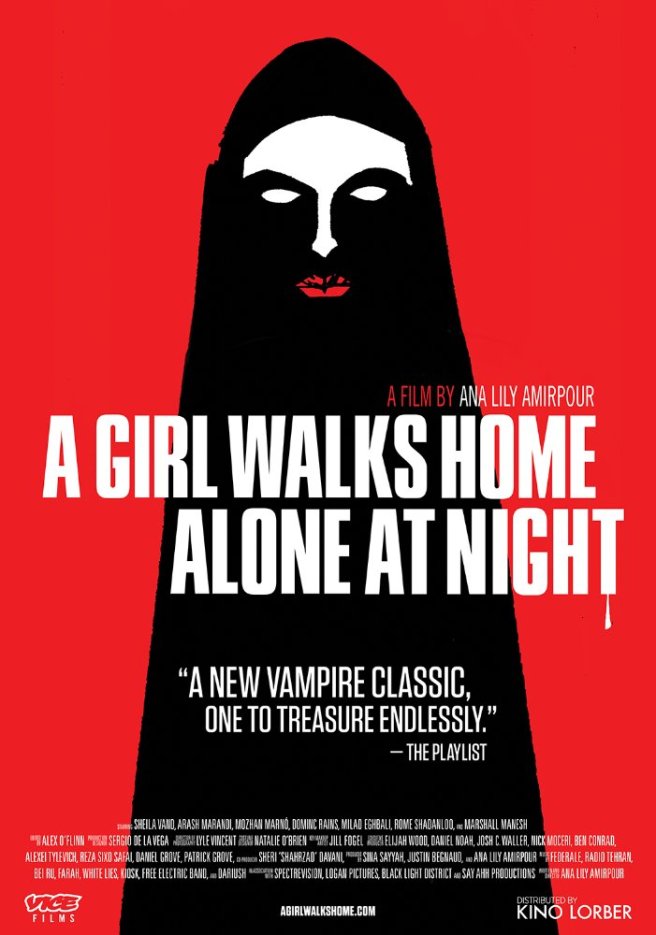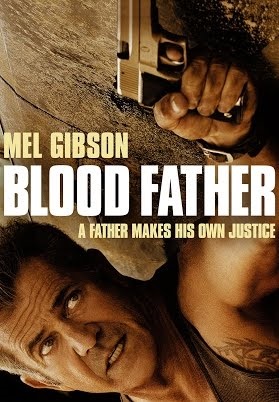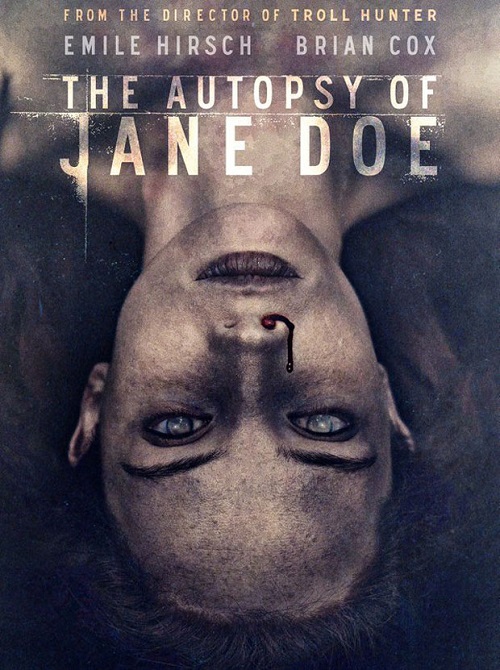L’avantage d’aborder un film en ignorant ce dont il parle, c’est qu’on est forcément surpris. J’ai regardé The big short : le casse du siècle, en croyant à priori (ne me demandez pas pourquoi, mais c’est sans doute la faute au sous-titre français et au casting) que c’était un film de braquage (oui, je sais, c’est inavouable ; raison de plus pour l’avouer). Donc, dans mon idée, avant que le film commence, c’était l’histoire de Christian Bale, sorte de génie du crime autiste, qui avec la complicité de Ryan Gosling, un petit arnaqueur de Wall Street dénué de la moindre once d’âme humaine, et de Brad Pitt, un trader parano vegan rangé des voitures, montent le casse du siècle, The Wall Street Job. Nuitamment, ils entrent dans une banque (Lehman Brothers ?) et en sortent avant l’aube avec des valises de bons au porteur, sans avoir eu à tirer ne serait-ce qu’un coup de feu (de toute façon, on leur donnerait un Glock, aucun d’eux ne saurait pas quel bout le prendre, contrairement à une raquette de squatch).
Mais en fait The big Short c’est pas du tout ça (même s’il y a un peu de ça).
Le film raconte comment une poignée de traders, banquiers, petits malins hors système découvrent l’affaire des subprimes, parient contre l’immobilier américain (c’est ça un « short » ; « shorter » : parier contre un marché) et s’en mettent plein les poches quand la bulle immobilière s’effondre et provoque, entre autres désastres, la faillite de Lehman Brothers. Sauf que The Big Short ce n’est pas encore tout à fait ça, car on comprend assez vite que nos petits malins parient sur des mécanismes boursiers « sains », (en fait, ce sont tous, plus ou moins, des idéalistes, sauf Ryan Gosling, évidemment, mais c’était couru d’avance). Alors apparaît une problématique encore plus vertigineuse : si les mécanisme sont « virtuels » (ou pipés ou théoriques ou frauduleux), car il n’y a plus rien de « sain » dans cette industrie, quels seront les effets réels des positions prises contre la bulle immobilière ?
Il y a quelques mois, j’avais vu Margin Call de J.C. Chandor qui raconte peu ou prou la même chose, mais du point de vue des traders qui prennent la crise en pleine gueule et voient leur château de cartes s’effondrer en temps réel. C’était excellent. Vraiment excellent.
The Big Short est encore plus bluffant, car le film, est non seulement extrêmement entraînant (un peu comme Le Loup de Wall Steet, les putes et la coke en moins). mais il est de surcroît pédagogique. On y apprend vraiment des trucs qui permettront de briller au Rotary Club de Cosne/Loire, avec des scènes d’explications à se tordre de rire (je spoile la première : Margot Robbie, à poil dans son bain, coupe de champagne à la main, nous explique à nous, pauvres débiles qui n’avons que 300 euros sur notre livret A, les subprimes).
Mais le meilleur dans tout ça, ce sont les acteurs : Christian Bale (peut être dans son meilleur rôle), Steve Carell (totalement méconnaissable et qui confirme à quel point, bien dirigé, il peut être génial), Gosling (qui fait du Gosling, mais bien, toujours à la limite du cabotinage : je vais me ramasser, vous croyez ?, vous le voulez ?, mais non bande de minables, hop! : d’un petit coup de rein facétieux j’évite de glisser sur la déjection canine à la dernière milliseconde), Brad Pitt (impérial, barbu et impérial, le Marc Aurèle de la fiance mondiale – j’ai vérifié sur une statue toulousaine, la ressemblance est frappante). Et tout le reste du casting est à l’avenant, avec des seconds rôles féminins assez jubilatoires.
Ne passez pas à côté : The big short est prodigieux (et c’est pas tous les jours qu’on peut dire ça d’un film américain).