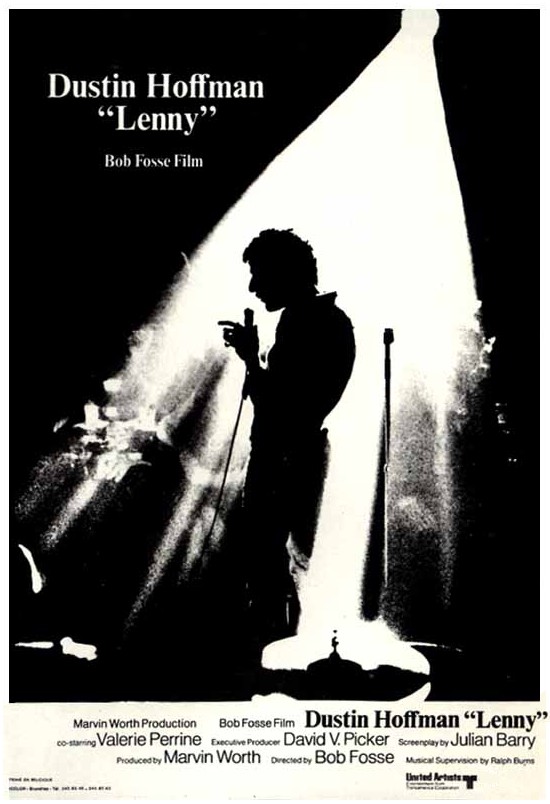Larry « Doc » Sportello (Joaquin Phoenix) est détective privé. En Californie. A une époque qui suit de très près l’affaire Charles Manson. Doc semble carburer à un régime marijuana / bière en canette / gaz hilarant, quasi-exclusif. Un jour, sa petite amie d’avant, Shasta (Katherine Waterston, fille de Sam Waterston, en photo ci-dessus, ne me remerciez pas) vient lui rendre visite. Elle s’est liée intimement avec un homme marié qui n’est autre que Michael Z. Wolfmann (Eric Roberts), un magnat de l’immobilier acoquiné avec des bikers néo-nazis. Shasta pense que l’épouse de son amant (avec l’aide de son amant à elle, faut suivre) mijote un mauvais coup et que ce serait bien de prévenir le procureur, et ça tombe bien car Sportello couche avec une substitut du procureur : Penny, très stricte d’apparence, mais les apparences sont parfois trompeuses. Surtout à cette époque-là, troublée. Peu de temps après, Shasta et Wolfmann disparaissent. Ensemble ? Séparément ? C’est ce que Doc Sportello va essayer de déterminer.
Raconté par le personnage secondaire de Sortilège (c’est son nom, parfois raccourci en Lège), Inherent Vice réussit la gageure de faire vivre à l’écran la prose de Thomas Pynchon, via une voix off très maîtrisée. Néanmoins un film n’est pas un livre et malgré toutes ses scènes réussies (mais parfois un peu forcées, probablement pour prétendre au statut de scènes-culte) le film de Paul Thomas Anderson paraît un tantinet émoussé et, paradoxalement, un peu à l’étroit. Joaquin Phoenix est étonnant, la plupart du temps méconnaissable. Katherine Waterston est belle comme un rayon de soleil sur un plage de Californie déserte, avec quelques rouleaux sous l’horizon. Josh Brolin est plus vrai que nature en flic frustré. Le monde décrit est corrompu, mollement mité par un monde hippie à l’agonie, qui va vite se déliter en minuscules communautés vouées à l’oubli. Les pouvoirs de l’argent vont définitivement gagner sur ceux de l’esprit et recouvrir tout le paysage, jusque là unanimement désertique, ou presque. Charles Manson a définitivement enterré le flower power. Sa croix gammée tatouée sur le front n’y changera rien.
Agréable, longuet, mais agréable, Inherent Vice reste mineur. On a connu Paul Thomas Anderson plus inspiré. Jamais il ne retrouve dans ce film l’incandescence de There will be blood ou l’audace de Magnolia. Et au fil du film, on ne peut s’empêcher de penser à The Big Lebowski des frères Coen, à The Nice Guys de Shane Black pour de mauvaises raisons, les deux comédies sus-citées ayant davantage d’abattage.