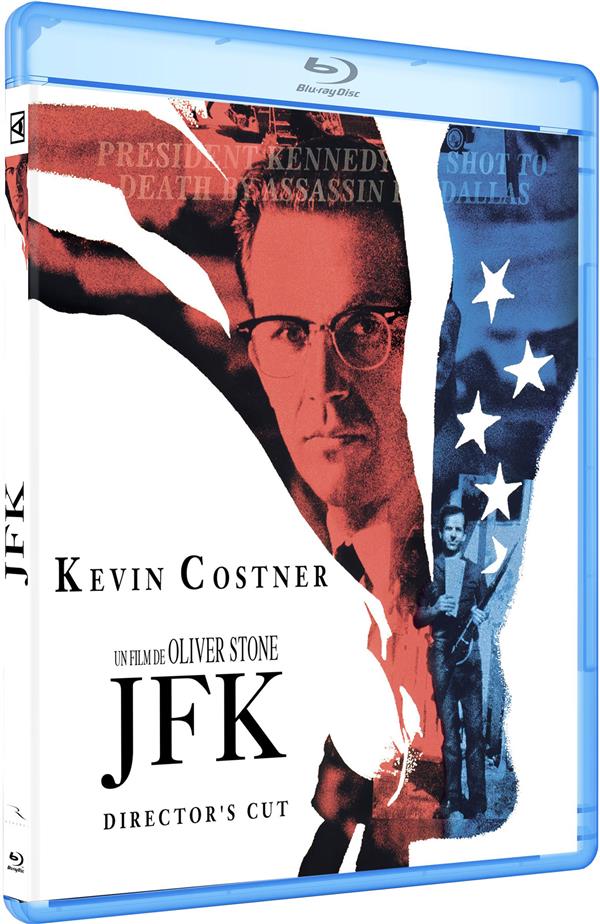In-man (Hwang Jung-min) est un tueur professionnel coréen. Il accepte un dernier contrat à Tokyo pour éliminer un yakusa particulièrement violent envers les femmes : Goreda. Le frère « de rue » de ce dernier, Ray (Lee Jung-jae) décide de le venger. Apprenant que son ancienne petite-amie a été tuée et découvrant qu’il est le père d’une petite fille de neuf ans qui vient d’être kidnappée par un gang de trafiquants d’organes, In-man se rend à Bangkok en ignorant qu’il a Ray aux trousses. Leur confrontation sera explosive.
Deliver us from Evil oppose deux des plus grandes stars du cinéma coréen : Hwang Jung-Min vu dans The spy gone north, New World, The Strangers, A Bittersweet life à Lee Jung-jae, vu dans New World, Squid Game, entre autres. Le résultat est complètement hors-norme, hystérique, outrancier. Lee Jung-jae qui joue d’habitude les hommes politiques machiavéliques ou les flics de la brigade financière est ici complètement à contre-emploi en chef de gang tatouée, ultra-violent. Et il faut bien le reconnaître über-cool dans sa démesure hémorragique. Sa prestation vaut la vision du film.
Ne cherchez pas un truc réaliste : chacun des personnages principaux reçoit à plusieurs reprises des blessures qui terrasseraient un rhinocéros sous cocaïne.
Donc, ce n’est pas un grand film ou même un bon film, mais ça se regarde comme un film d’action de Jason Statham ou un des inénarrables massacres de Liam Neeson (tous écrit sur le même modèle : on tue quelqu’un à qui le grand Irlandais tient, puis il massacre tous les méchants).
Deliver us from Evil est un plaisir coupable. Un vrai. Qui étrangement ne manque pas, aussi, de scènes d’émotion.