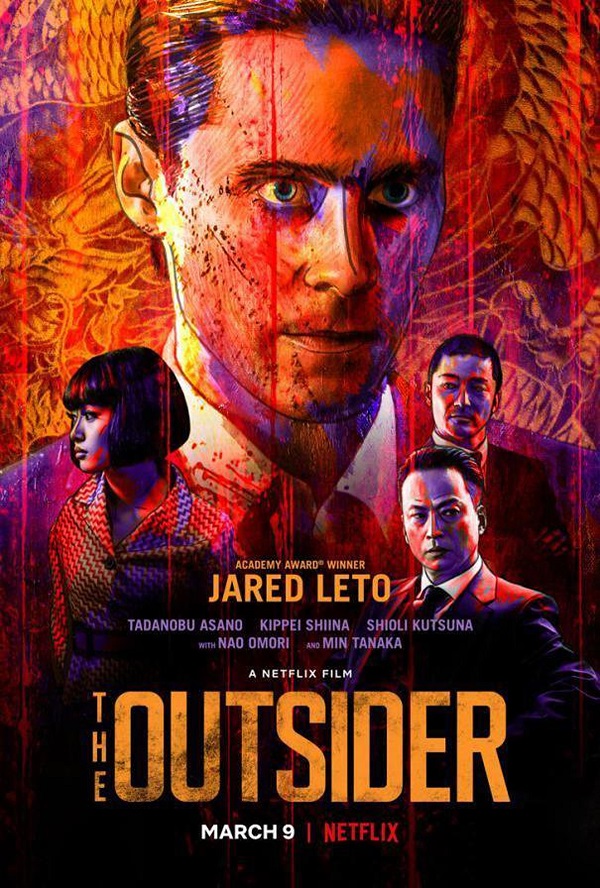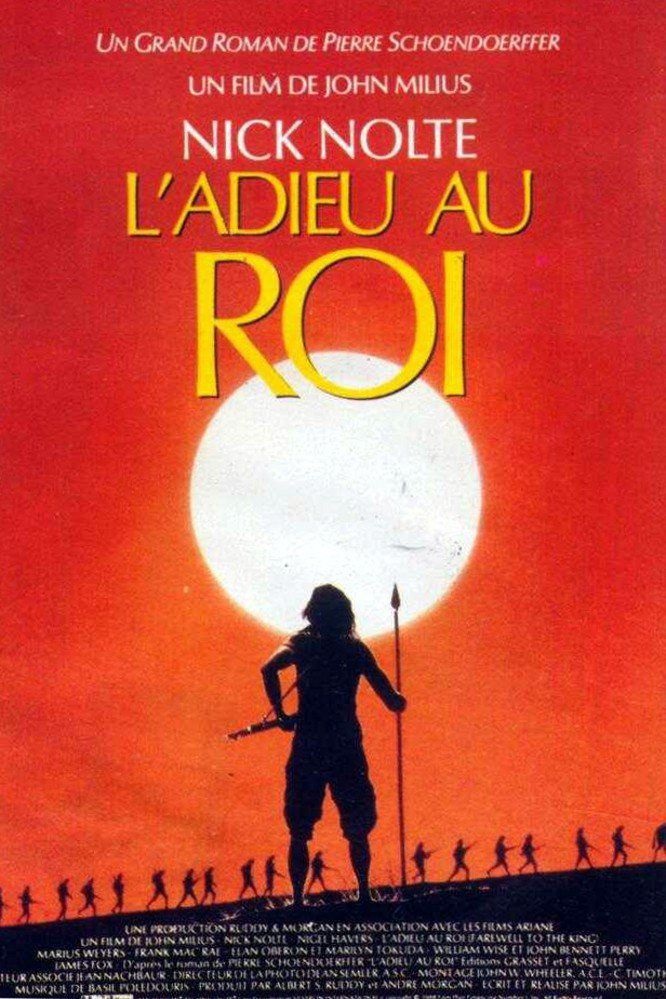//
Fin des années 1910. Un homme d’affaires américain, M. Grant, promet 10 000 dollars à quatre hommes s’ils lui ramènent sa femme, Maria (Claudia Cardinale, nichons droit devant), prisonnière du révolutionnaire mexicain Jesus Raza (Jack Palance), 160 kilomètres au sud de la frontière. L’équipe se forme donc avec un expert en armes automatiques qui a participé à la révolution mexicaine et d’une certaine façon y a tout perdu (interprété par Lee Marvin), un cow-boy au grand cœur amoureux des chevaux (interprété par Robert Ryan), un éclaireur noir expert en tir à l’arc (Woody Strode) et un expert en explosifs coureur de jupons, interprété par Burt Lancaster. Maria est retenue prisonnière dans une hacienda où vit une centaine de révolutionnaires armés jusqu’aux dents et leurs familles. Comment quatre hommes vont-ils triompher d’une petite armée ?
Quand on regarde la filmographie de Richard Brooks, plutôt passionnante (Graines de violence, Lord Jim, Les frères Karamazov, De sang froid, entre autres), on peut légitimement se demander ce qu’un réalisateur d’un tel calibre, passionné de problématiques sociétales, vient faire dans un western qui a priori sent l’action, le courage et la testostérone à plein tonneaux ? Et c’est là où le film devient passionnant, oui c’est un grand film d’aventures avec son lot de fusillades, cavalcades, explosions et catastrophes naturelles, qu’on peut regarder au premier degré, mais c’est aussi un film audacieux (nous sommes en 1966, une année avec la révolution morale qu’a constitué la sortie du Bonnie and Clyde d’Arthur Penn) qui pervertit les codes habituels du western (on le sent en filigrane, le vrai sujet du film, ce sont les transformations qui vont frapper la société américaine à la fin des années 60 : la montée en puissance du pacifisme et la révolution sexuelle). 1966 c’est l’année du Bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Sam Peckipah n’a pas encore tourné La Horde sauvage (1969) (qui entretient de nombreux points communs avec Les Professionnels), Sergio Leone n’a pas encore tourné Il était une fois dans l’ouest (1968) et Il était une fois la révolution (1971). Richard Brooks amorce une partie de tout ça (la fête mexicaine qui dure jusqu’à l’aube en évoque une autre, qui finira aussi très mal à cause d’une femme), comment ne pas considérer Dolworth (interprété par Burt Lancaster) comme l’exact opposé du dynamiteur irlandais de Il était une fois la révolution ? Comment ne pas penser à Claudia Cardinale dans Il était une fois dans l’ouest ? Quand Grant demande « ça ne dérange personne de travailler avec un nègre ? », aucun des futurs compagnons ne répond. Et tout au long du film, Jake sera considéré comme un compagnon à part entière, jamais comme quelqu’un d’inférieur ou de subalterne. Brooks est malin, il ne le dit jamais, il le montre, c’est tout, il ne le souligne pas.
Autre aspect qu’il affronte, mais de façon moins subtile, ou disons plus frontale, c’est la sexualité. Dolworth (Burt Lancaster) est constamment en rut ; d’ailleurs il est au lit avec une femme mariée la première fois qu’il apparaît dans le film. Traitée de pute à plusieurs reprises, Maria en est l’exact opposé, la femme fidèle à son amour d’adolescence, fidèle jusqu’au bout, quoi qu’il en coûte. Mariée contre son gré, c’est une femme violée, ni plus ni moins. Son corps n’a qu’une seule cause, celle de son amour véritable. Personnage secondaire, Chiquita, la révolutionnaire qui accompagne Raza, est aussi un personnage extrêmement audacieux pour l’époque, elle se bat comme un homme, jusqu’à la dernière cartouche, et semble avoir elle aussi complètement abandonné son corps à une cause : la révolution mexicaine, endossant deux rôles, celui de guerrière et celui de repos du guerrier. En esquissant sans gros sabots le destin de ces deux femmes très différentes, mais qui trouvent de la puissance dans le choix qu’elles font de leur sexualité, Brooks se montre une fois de plus très malin. Ce western a priori masculin, suintant la testostérone comme la dynamite suinte sa nitroglycérine au soleil, soulève bien des questions embarrassantes sur le désir masculin et sur le patriarcat. D’ailleurs, Brooks oppose finement Dolworth, qui est prêt à coucher avec n’importe quelle femme (mariée, prostituée, révolutionnaire, ça n’a pas grande importance à ses yeux) à Chiquita qui est prête à coucher avec n’importe quel homme qui partage son idéal politique et à Maria qui met l’amour au firmament de ce qu’est sa condition humaine (l’amour ou la mort). Dans Les Professionnels les femmes ont plus de conviction que les hommes, à part peut-être Fardan (Lee Marvin) qui, veuf, semble avoir troqué sa sexualité (et même sa vie émotionnelle) pour une rectitude infrangible. Lui aussi sortira transformé de sa chevauchée au Mexique.
Les Professionnels est un western crépusculaire qui, entre deux fusillades, abordent la politique, la sexualité, la morale, le patriarcat et le racisme (les droits civiques, le pacifisme et la révolution sexuelle). Il fallait tout le talent de quelqu’un comme Richard Brooks pour maquiller ce brûlot politique en film d’action à grand spectacle. Là où Brooks se démarque totalement de Peckinpah, c’est dans le refus d’esthétiser la violence, chez Brooks la violence est une conséquence de choix moraux plus ou moins défendables, mais elle n’est pas un sujet en elle-même. D’ailleurs il semble dire qu’à partir d’un certain moment, un conflit n’est plus l’affrontement d’idéaux ou de systèmes politiques, mais une mauvaise habitude dont on ne sait plus se débarrasser (en 1966, en pleine guerre du Viêt-nam, il fallait être sacrément courageux pour oser poser un tel diagnostic).
Un immense classique.