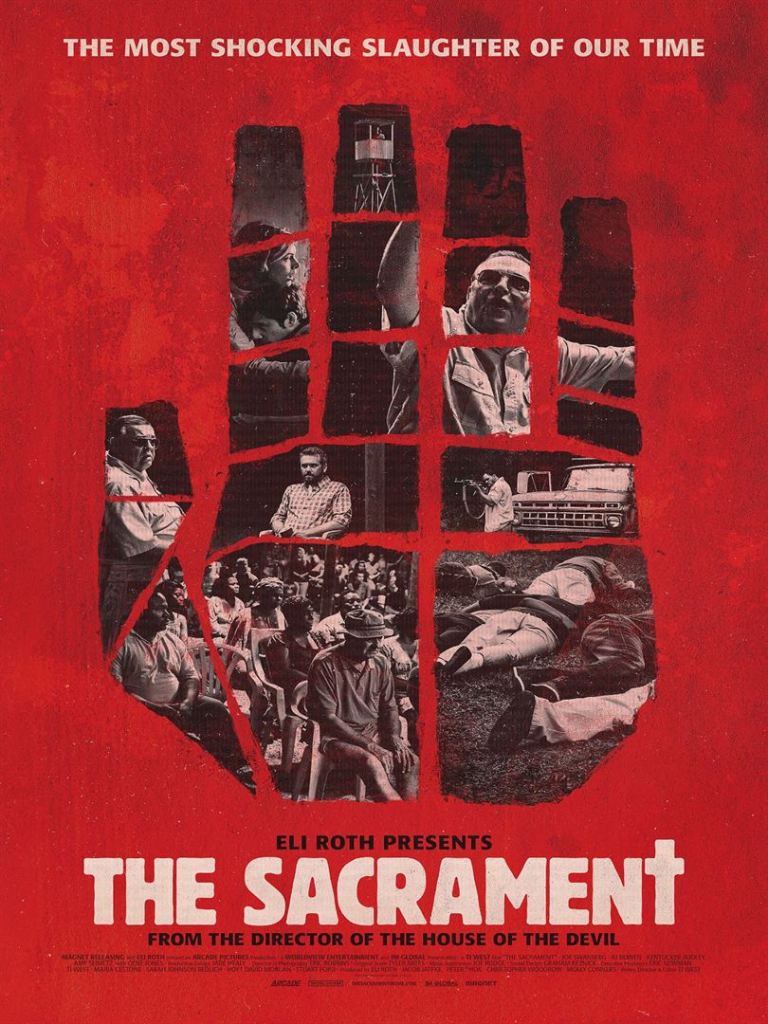Un professeur allemand (Omar Sharif), qui a tout perdu, fuit les combats de la guerre de trente ans dans une vallée isolée, où tout le monde mange à sa faim, où la guerre semble très lointaine. Juste après son arrivée, une troupe de mercenaires débarque. Menée par le Capitaine (Michael Caine). Ils s’installent au village et demandent six femmes pour le repos des guerriers. Des femmes sont choisies. Le Capitaine se rapproche de la sorcière du village, près, trop près. Une femme, Inge, promise à un jeune homme, se lie avec le professeur qui, pour survivre, va devoir se rendre indispensable et va jouer avec les superstitions des villageois.
L’esprit humain est étrange. Très déçu par la nouvelle adaptation de Shogun, j’ai décidé de revoir La Vallée perdue de James Clavell. J’ai été surpris de voir à quel point ce film fait office de terreau d’inspiration au classique de Paul Verhoeven La Chair et le sang. La Vallée perdue n’est pas exempt de défauts et a mal vieilli sur certains point, mais ça reste un très bon film. Parmi les défauts, il est totalement impossible de considérer Omar Sharif comme un potentiel professeur allemand de la guerre de trente ans, malgré tout les efforts de son coiffeur ou de sa coiffeuse. Ce choix de casting est étrange. Les scènes de batailles sont pataudes et manquent de force, on est très loin de ce que Mel Gibson va imposer avec Braveheart, beaucoup plus tard, il est vrai.
Une fois de plus, l’acteur Michael Gothard crève l’écran dans le rôle de Hansen, la pire fripouille du Capitaine.
Le film regorge de thèmes : la foi, la religion, le viol, la guerre, la sorcellerie. Ma foi, tout est assez bien traité. Par certains côtés, c’est d’une radicalité assez surprenante pour un film de 71 (très bonne année, puisque c’est celle qui m’a vu naître).
Il existe une version blu-ray espagnole avec des sous-titre français. Ce n’est pas la version que je possède. J’ai un vieux DVD anglais sans sous-titres français.
A découvrir, ne serait-ce que pour la prestation étonnante de Michael Caine.