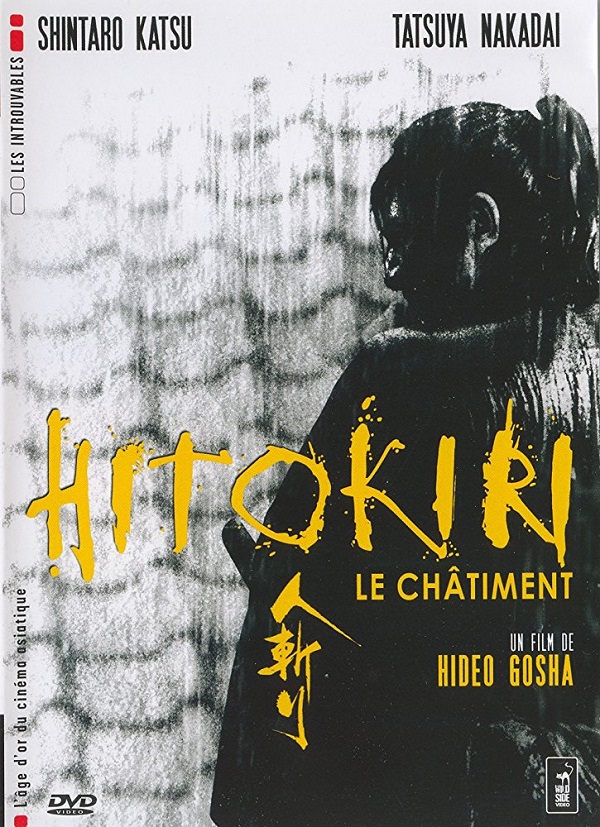Prague 1942. Deux soldats tchèques, Jan Kubiš et Josef Gabcik, sont parachutés en Tchécoslovaquie pour assassiner Reynard Heydrich, numéro 3 de la hiérarchie nazie et père de la « solution finale ».
De l’opération Anthropoid, je ne connaissais que ce que j’en avais lu dans une bande-dessinée qui m’avait alors semblé très sérieuse sur le plan historique. Le film s’intéresse à l’assassinat d’Heydrich et à ses conséquences. Je ne vais pas spoilier, mais disons que c’est un long-métrage tranché en son mitan : avant / après.
Je ne suis pas un grand fan de films de guerre et je supporte de moins en moins les scènes de torture sur grand écran, donc je ne suis clairement pas bien « tombé » avec ce film… que je voulais voir principalement pour Cillian Murphy, un acteur que j’apprécie beaucoup, surtout quand il évite de travailler avec Christopher Nolan.
Le film a quelques qualités, il rend palpable l’horreur de l’occupation nazie, la peur, la paranoïa, l’humanité de ceux qui trahissent. Charlotte Le Bon y est magnifique ; elle illumine de sa présence chacune de ses scènes, même les plus anodines. Pour le reste, j’ai trouvé le montage anémique, la photo terne, la réalisation fadasse. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à la façon dont Jean-François Richet avait mis en scène la mort de Mesrine, et de comparer cette « mise à mort » avec l’attentat contre Heydrich tel qu’il nous est montré dans Anthropoid. La maestria de Roman Polanski dans Le Pianiste m’est souvent venu à l’esprit : un Polanski à la fois plus subtil et plus vigoureux dans sa cinématographie que Sean Ellis.
Quant à la fin du film, elle m’a rappelé John Wick 2, et ce moment passé de l’histoire du cinéma où celui-ci a commencé a flirter avec la grammaire visuelle des jeux vidéos de combat. Je ne connais rien aux First Personnal Shooter, mais John Wick 2 et dans une moindre mesure cet Anthropoid, ressemblent par moment à une partie de FPS ou du moins en reprennent certains codes de cadrage, mise en scène, position de caméra. Je n’arrive pas à croire que les soldats allemands qui ont affronté les soldats tchèques et les résistants impliqués dans l’opération Anthropoid pussent avoir été aussi bêtes, mal entraînés et maladroits que ceux qu’on nous montre à l’écran.
Les dernières scènes du film, tournées par un virtuose de l’action tel que Michael Mann ou Mel Gibson, auraient été probablement inoubliables.
Paradoxalement, Anthropoid m’a donné envie de voir HHhH de Cédric Jimenez, sur le même sujet, avec Jason Clarke dans le rôle d’Heydrich.