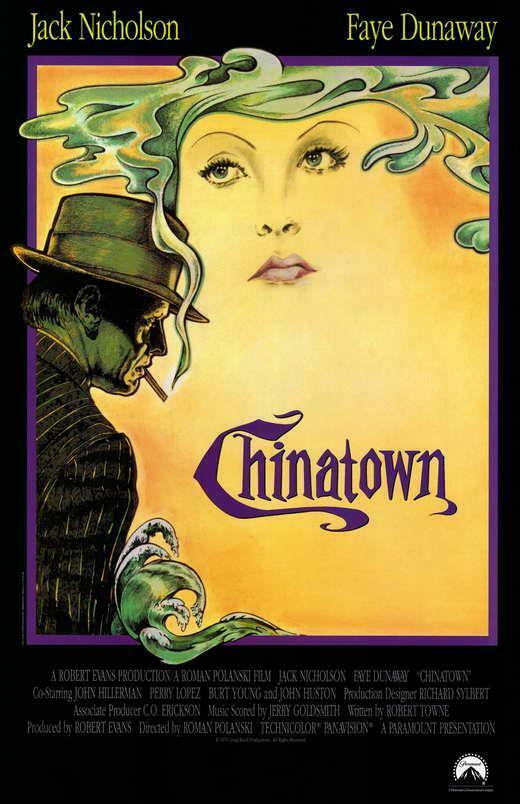États-Unis, années 30, juste après la crise de 29.
George Pemberton (Bradley Cooper), qui a eu la bonne idée d’engrosser sa cuisinière, possède une exploitation forestière dans les Smoky Mountains de Caroline du nord, montagnes qu’il est bien décidé à « raser ». Il possède aussi des terres au Brésil pour lesquelles il s’est endetté. Durant un déplacement professionnel – il faut savoir calmer les banques – il rencontre Serena (Jennifer Lawrence), une jeune femme qui a grandi dans une immense exploitation forestière du Colorado et a tout perdu dans un incendie. Sans même la connaître, il la demande en mariage et elle accepte. Arrivée dans l’exploitation forestière de George, Serena reprend tout en main et fait venir un aigle pour se débarrasser des crotales qui tuent ou blessent les bûcherons.
Un projet de parc naturel va mettre le feu aux poudres.
Échec commercial cinglant (30 millions de budget, 5 millions de recettes mondiales – aouch) Serena déçoit. On ne cesse d’imaginer un autre film. Dirigé par Martin Scorsese (n’est-on pas près de son Killers of the flower moon ?) ou Paul Thomas Anderson (There Will be blood). Le couple de stars est un peu trop propre. Jennifer Lawrence joue Serena, mais n’est pas Serena. On imagine Jessica Chastain à la place. Ou (mieux ?) Andrea Riseborough. Le choix de l’excellent Rhys Ifans dans le rôle du trappeur est lui aussi étrange, il est un poil trop distingué / guindé. Tobie Jones en Sheriff, ça aussi c’est étrange, même si pas totalement dénué d’intérêt (après, je ne vois pas quel genre d’Américains des années 30 éliraient Tobie Jones comme Shériff). A aucun moment, Susanne Bier n’arrive à amener Serena, cette Lady Macbeth des Smoky Mountains, à son point d’incandescence. Tout le contraire de ce que Martin Scorsese avait réussi avec Lily Gladstone dans Killers of the flower moon bouleversante dans la dernière demi-heure du film.
Le plus décevant, c’est sans doute l’incapacité de la réalisatrice danoise (il ne faut pas l’oublier) à mettre en scène la nature, pourtant au centre du film (et de ses enjeux). Elle ne sait pas la valoriser, opposer sa sauvagerie à celle des hommes (et d’une femme).
On ne passe pas vraiment un mauvais moment, disons que c’est « tenu » de bout en bout, mais tout ça est trop sage, trop lisse, à l’image des deux stars (Cooper et Lawrence) qui font plus démonstration de leur statut que de leur talent.
Quelqu’un comme Jacques Audiard (The Sisters brothers) ou Alejandro González Iñárritu (The Revenant) aurait tout explosé avec un scénario de ce genre.
(Le roman de Ron Rash se trouve facilement d’occasion à un prix raisonnable.)