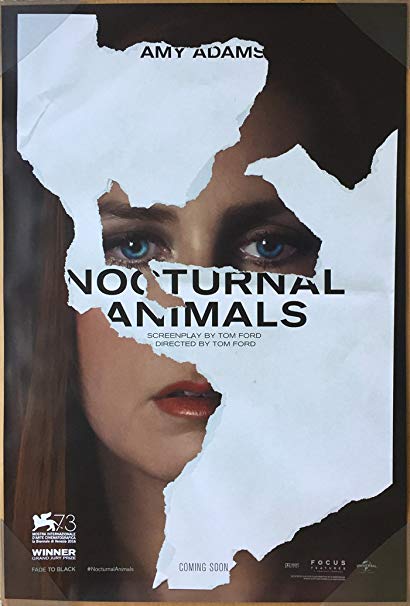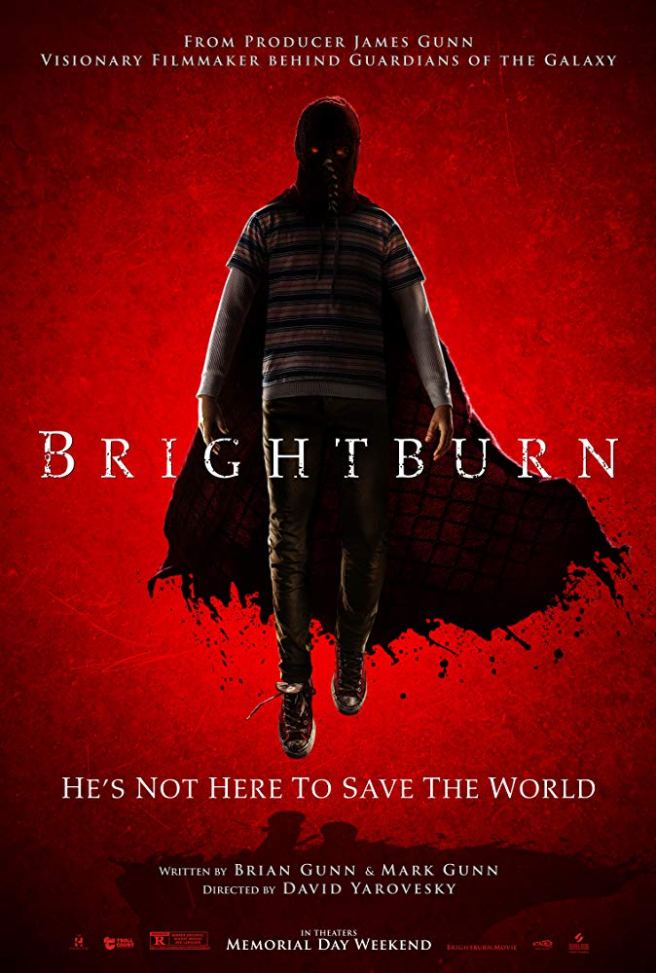//
Quatre américains (trois hommes, une jeune femme qui vient de perdre ses parents et sa sœur dans des conditions atroces) se rendent en Suède dans une communauté isolée très secrète où on vit au rythme des saisons de la vie (l’été correspondant à la période entre 18 et 36 ans). Témoins d’un rite (proprement atroce) qu’ils jugent inacceptable ou fascinant selon les sensibilités des uns et des autres, leur groupe explose. Il y a ceux qui veulent rester étudier cette communauté à fin d’écrire une thèse d’anthropologie dessus et ceux qui veulent fuir le plus tôt possible.
Je n’avais pas du tout aimé Hérédité, le précédent film d’Ari Aster qui m’avait semblé trop long avec un casting assez bancal, dont un Gabriel Byrne complètement à côté de la plaque notamment (peut-être fait exprès, mais ça m’avait sorti du film). Par conséquent, je me suis lancé dans ce Midsommar à reculons.
Midsommar est long (le blu ray compte deux montages, un de 2h27 et un de 2h51 – je ne me suis pas risqué à voir la version longue, mais j’y viendrai), il est d’autant plus long qu’il contient assez vite une scène particulièrement éprouvante (qui à mon sens justifierait une interdiction au moins de seize ans ; mes deux fils ont plus de douze ans, l’un comme l’autre, et je me vois mal accepter l’idée qu’ils regardent un tel film). Midsommar peut être très éprouvant, donc, il est aussi très drôle. Farci ras-la-gueule d’un humour tordu qui joue sur ce qu’on comprend et ce que ne comprennent pas ou refusent de comprendre les personnages américains (particulièrement abrutis, il faut le reconnaître). La photo est à tomber, la mise en scène est souvent bluffante. D’un point de vue esthétique, le film rappelle un Lars Von Trier au meilleur de sa forme (Antichrist reste un sommet de l’horreur esthétique). Pour l’humour, j’ai plutôt pensé à Ben Wheatley quand il laisse s’exprimer sa fibre la plus horrifique. Midsommar est aussi intéressant sur le plan philosophique et/ou religieux – la communauté qui nous est montrée n’est pas totalement maléfique / monstrueuse, elle retire des bénéfices de ses actes choquants, probablement une forme de stabilité, d’harmonie et d’équilibre. De bonheur…
Le film pose donc une question très dérangeante, mais aussi assez profonde, que seriez-vous prêt à sacrifier pour la stabilité, l’harmonie et l’équilibre de ceux que vous aimez (vos enfants avant tout) ? Les enfants de la communauté sont un peu laissés de côté par le film, mais ils sont bien présents. Il y a dans cette facette du film quelque chose de Lovecraftien – on pense évidemment au Cauchemar d’Innsmouth. On peut évidemment s’arrêter au côté New Age des rites et ne pas chercher à comprendre à quoi tout cela rime. Mais à bien y réfléchir, les rites ne sont que l’habillage symbolique d’une mécanique qui permet de garder cohérent un ensemble de personnes relativement différentes.
Mon sentiment final est mitigé, j’ai détesté les scènes d’horreur graphiques que j’ai trouvées inutilement réalistes, complaisantes, et qui m’ont rappelé les pires excès de Gaspard Noé, réalisateur dont je reconnais la démarche artiste, mais dont aucun film ne m’a jamais plu (ou « enrichi »). J’ai adoré la photo, l’ambiance, la mise en scène, l’humour noir, l’humour glauque, l’incroyable scène de sexe, audacieuse dans sa volonté de tout montrer, y compris des corps saccagés par le passage du temps. Résolument, une des plus originales de l’histoire du cinéma.
Seul Ari Aster est crédité au scénario, mais son Midsommar m’a semblé très (trop ouvertement) inspiré de The Wicker Man (1973), le classique de Robin Hardy (à voir absolument, si vous ne connaissez pas – il est regrettable d’ailleurs que The Wicker Man soit souvent commercialisé avec une jaquette qui spoile la fin du film).
Si vous avez l’estomac bien accroché, n’hésitez pas à visionner ce Midsommar. Ce n’est probablement pas totalement réussi, il faut un peu s’accrocher parfois (à cause de la longueur et de la complaisance dans les scènes d’horreur), mais c’est sans doute inoubliable malgré tous ces défauts (remarque qui peut s’appliquer à beaucoup de films de Lars Von Trier, on y revient).
//