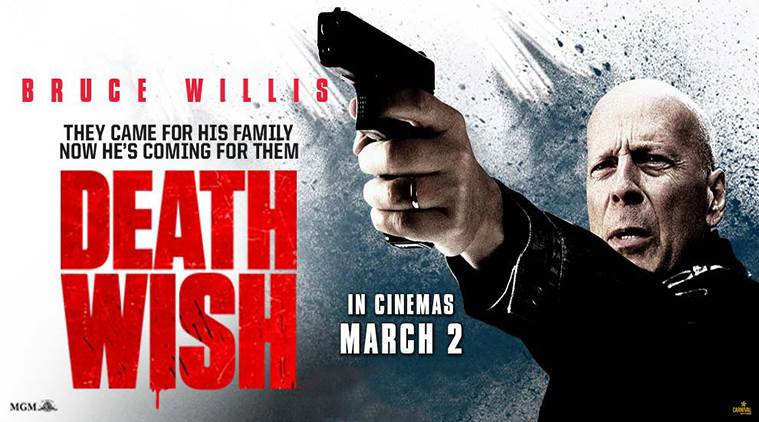Dans un complexe de recherches scientifiques à la pointe de la pointe de l’exploration virtuelle de l’esprit humain, Catharine Deane (Jennifer Lopez) s’introduit dans la pensée rémanente de ses patients dans le coma pour essayer de les aider à en sortir. La procédure est complexe (il y a un hôte et un invité), dangereuse et d’un très haut degré technique. Frustrante, cette technologie encore expérimentale ne donne pas de résultats immédiats, mais elle reste prometteuse pour certains patients dans un coma profond.
Carl Stargher (Vincent D’Onofrio, dans ce qui restera à jamais une de ses plus grandes performances d’acteur) est un tueur en série particulièrement perturbé. Il emprisonne des femmes dans une cellule, les noies lentement puis les transforme en poupée avant d’assouvir ses fantasmes sexuels avec leurs cadavres. Le FBI est sur ses traces, et comme Carl possède un berger allemand albinos, le FBI se rapproche. Pour finalement le trouver plongé dans le coma à la suite d’une attaque. De fait, Carl est dans l’incapacité de fournir la location de sa dernière victime, potentiellement toujours en vie, mais Catharine pourra peut-être aider le FBI.
J’ai vu ce film au cinéma quand il est sorti (il faut dire qu’à l’époque on n’avait pas beaucoup de films de ce genre, mêlant thriller et science-fiction à se mettre sous la dent et donc je n’en ratais aucun). J’ai le souvenir qu’il ne m’avait pas beaucoup plu à l’époque. Avec le recul, je pense que j’étais passé complètement à côté de ses enjeux qui sont beaucoup plus spirituels qu’on pourrait le croire de prime abord. Le sauvetage de la victime est en fait très secondaire et intéresse nettement moins le réalisateur que la maladie de Carl, ses origines, ses symptômes, sa dimension esthétique. The Cell regorge d’images religieuses, de visions mystiques, certaines d’ailleurs ne sont pas du tout expliquées (le diable se cache dans les détails et j’ai remarqué sans doute moins de choses que je n’en ai laissé passer). The Cell regorge aussi de visions absolument renversantes, comme la scène que je surnommerai pour le plaisir « le roi sur son trône ». D’Onofrio est bluffant ; Jennifer Lopez, par contre, n’a pas la palette d’une Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling, Vince Vaughn manque un peu de métier (ce qu’une coiffure ridicule n’arrange pas), mais bon ne boudons pas notre plaisir, car malgré des scènes parfois un peu molles, The Cell est épisodiquement sidérant. Il joue aussi avec beaucoup de codes du film de serial killer, faisant de la guérison (ou à défaut du diagnostic) un enjeu plus important que celui de la punition.
Vraiment intéressant ; il ne plaira pas à tout le monde, certaines de ses scènes d’horreur pure sont vraiment perturbantes, mais je le conseille.
PS : Je l’ai vu en blu-ray dans l’édition qui vient tout juste de paraître et que j’avais pré-commandée de longue date. Je ne sais pas si ça vient de mon blu-ray, de mon « pressage », mais j’ai trouvé le son catastrophiquement faiblard. D’habitude, c’est le genre de détails techniques auxquels je m’intéresse guère, mais là ça m’a quand même interpellé, puisque j’ai dû régler deux fois le son de la télé avant de trouver le volume sonore idéal pour préserver les dialogues sans se laisser complètement assourdir par la musique.