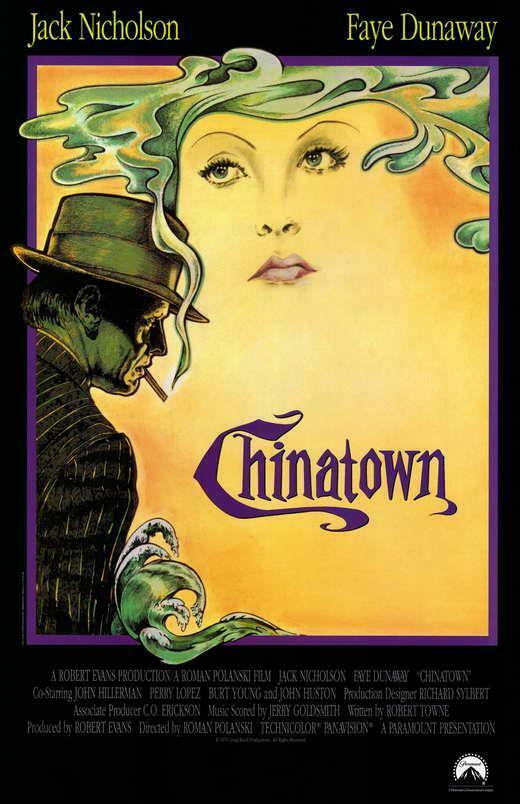L’ancien premier ministre britannique Adam Lang (Pierce Brosnan) a écrit ses mémoires avec l’aide d’un de ses fidèles collaborateurs. Mais voilà que l’homme est retrouvé mort sur une plage et qu’il doit être remplacé de toute urgence. La maison d’édition qui a acheté à prix d’or les mémoires d’Adam Lang fait appel à un nègre (Ewan McGregor, parfait). En villégiature sur une île des USA, Adam Lang se trouve mis en examen par la cours pénale internationale pour des faits de crimes de guerre (pour rappel, les USA ne reconnaissent pas la CPI). C’est dans cette ambiance que le nègre commence son travail et fait la connaissance de Ruth (Olivia Williams, impressionnante), la femme d’Adam. Alors que l’ancien premier ministre a l’air d’un parfait idiot dont on ne comprend pas bien comment il a pu accéder à autant de responsabilités, Ruth semble au contraire une femme remarquable, d’une intelligence aussi aiguisée qu’un scalpel.
Chaque fois que je vois ce film, je suis impressionné, et je l’ai vu plusieurs fois dans ma vie. C’est un des rares films (à ma connaissance), avec Misery, à bien parler d’écriture… qu’est-ce qu’écrire ? A quoi ça sert ? Au-delà de cette problématique, qui m’intéresse pour des raisons évidentes, Roman Polanski dresse un portrait au vitriol du passage de Tony Blair au 10 Downing Street. La partie écriture est intéressante, la partie politique est passionnante. Roman Polanski sait mieux que quiconque installer une atmosphère angoissante (le film nous rappelle indirectement que Polanski réalisa Rosemary’s Baby en 1968). Passée la première heure du film, The Ghost Writer verse dans le thriller de haut-vol et ne faiblit jamais, malgré ses deux heures bien tassées.
Je conseille.